Cette semaine, je reçois ici mon amie Nadia Cohen (alias Sylphelle pour les rôlistes), pour une discussion un peu différente à propos du JDR.
Elle et moi avions envie de vous parler du jeu de rôle sous un autre angle—un que vous avez probablement utilisé sans vous rendre compte. Un angle qui fait partie intégrante de ma vie, ainsi que du travail de Nadia.
Parce que le JDR, c’est hyper ludique, mais c’est aussi un outil thérapeutique et pédagogique pour de nombreuses personnes.
Alors merci Nadia, déjà, d’avoir pris le temps de venir partager ton expérience avec nous! 🩵
Présentations
Nathalie—Je suis maman de deux jeunes enfants neuroatypiques, maintenant ados. J’ai écrit plusieurs livres de fiction et non-fiction, tenu un des plus gros blogs francophones sur l’autisme en 2009, et j’ai un passé qui a beaucoup tourné autour de relations toxiques, dont j’ai appris, par la force des choses, de nombreuses choses.
Et toi, Nadia, peux-tu te présenter?
 Nadia—Merci Nathalie pour ton accueil! Je suis rôliste, MJ et autrice de jeux de rôles et de GN (avec un jeu qui va bientôt sortir aux éditions HOBG).
Nadia—Merci Nathalie pour ton accueil! Je suis rôliste, MJ et autrice de jeux de rôles et de GN (avec un jeu qui va bientôt sortir aux éditions HOBG).
Dans la vie, je suis une ancienne pédagogue didacticienne des sciences: j’ai étudié et vulgarisé la biologie et les neurosciences. Le fonctionnement du cerveau et des modes d’apprentissage me passionne!
Je suis maintenant à mon compte depuis 2016, en tant que thérapeute et pédagogue. J’ai une patientèle avec qui je pratique le JDR (jeu de rôle sur table), le GN (jeu de rôle grandeur nature) et le théâtre de l’opprimé de manière thérapeutique.
J’anime trois clubs de jeu de rôle (enfants et ado) dans une MJC depuis 2021, et je fais du soutien scolaire spécialisé pour les jeunes neuroatypiques (je travaille avec des jeunes ayant des particularités DYS, TDAH et TSA ou des troubles de l’apprentissage et de la mémoire).
Je fais souvent des liens entre les neurosciences et le jeu/les modes d’apprentissage et le jeu de rôle est mon outil préféré pour aider les gens à avancer.
Le “je” par le jeu
Nathalie—Moi, de mon côté, j’ai vite compris que pour aider mes enfants à devenir de plus en plus autonomes, il fallait absolument ajouter du ludique par tous les moyens. C’était la seule façon de les intéresser, et de les canaliser suffisamment longtemps pour apprendre de nouvelles compétences.
C’est aussi, notamment, un des livres dont je me repaissais, celui d’Anne Idoux-Thivet, qui parlait de trouver le “je” par le jeu—dans son livre, elle parlait des jeux de société, mais le jeu en général est un outil efficace qui permet de générer des avancées.
Alors j’ai beaucoup utilisé leurs intérêts spécifiques à l’époque—ces zones un peu obsessionnelles pour les enfants autistes, pour les faire avancer dans les apprentissages et l’autonomie. On utilisait les jeux vidéos pour ça. La motivation venait du fait de “gagner des niveaux”, ce qui aidait mon fils cadet, par exemple, à accepter de tenter de manger des morceaux, ou à s’efforcer de faire des exercices de motricité fine.
Nadia, peux-tu me dire ton expérience en la matière, qui tourne plus autour du jeu de rôle?
Nadia—J’utilise beaucoup le jeu de rôle pour aider les patients et patientes en perte de repère à se définir et à se dépasser. J’ai créé un protocole qui fonctionne bien pour certaines demandes et qui utilise l’alibi du personnage de jeu de rôle.
En définissant un personnage et en l’animant à travers le jeu les gens prennent du recul sur leurs comportements et ceux des autres (qui sont des PNJ que j’anime). Je leur demande aussi de se situer par rapport aux personnages qu’ils ont créé à un moment du protocole et ça les aide beaucoup.
Il y a beaucoup de personnes, (surtout des femmes malheureusement) qui ne savent pas bien qui elles sont parce ce qu’elles ont toujours suivi des codes sociaux et des logiques masculines. Beaucoup se définissent principalement dans des positions d’aidantes, de soigneuses, de sauveuses ou de suiveuses dans leur vie actuelle parce que la société les pousse dans ces positions. Elles parlent peu d’elles et de leurs besoins car elles les connaissent mal et la plupart des problèmes que je soigne viennent de là.
Créer un personnage puis l’animer à travers le jeu de rôle, analyser tout ça avec moi ensuite, leur permet petit à petit de mettre des mots sur qui elles sont et qui elles ne sont pas, de mieux cerner leurs envies et leurs attentes ou leurs besoins.
Tu parlais tout à l’heure de sortir de relations toxiques: pour y arriver une des étapes essentielles est de connaître ses besoins et ses limites et de les respecter. J’utilise l’alibi du personnage exactement pour ça: si on arrive pas se définir soi devant une grande feuille blanche, c’est beaucoup plus facile de se comparer à l’autre. Dans mon cas l’autre est le personnage (qui comporte une bonne partie de soi!).
J’anime aussi des groupes thérapeutiques sur l’affirmation de soi et la gestion des conflits. Dans ces groupes, on utilise le théâtre de l’opprimé et le jeu de rôle grandeur nature pour rejouer des scènes de la vie qui ont posé problème. Le fait d’endosser des rôles variés (oppresseur, victime, témoin…) ou de rejouer son propre rôle permet des prises de consciences sur ses mécanismes, ses comportements, ses croyances… Ce n’est pas nouveau comme technique puisque c’est utilisé en Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC) depuis des années (si je ne me trompe pas, c’est apparu autour de 1960). Le jeu de rôle permet réellement de grandes avancées dans certaines thérapies.
Adapter le JDR aux différents besoins
Nathalie—De mon côté, les difficultés les plus grandes avec mes enfants ont été les difficultés d’imitation, et l’absence de jeu symbolique chez eux (assez courants, il me semble, chez les enfants autistes) lorsqu’ils étaient jeunes. C’est un des points que j’ai eu le plus de mal à aborder avec eux, car d’aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais eu pour ma part ces difficultés-là. Du coup, difficile de faire intervenir le jeu de rôle dans ce cas-là.
Tu parles de TCC, et c’est justement ce que j’ai choisi pour mes enfants. Ils sont nés à une époque où il était habituel de les fourrer dans des structures occupationnelles—et les psychiatres, souvent psychanalystes, poussaient les parents à les abandonner et laisser “les professionnels s’en occuper”.
J’ai eu la chance de trouver un pédopsychiatre qui a bien voulu me suivre dans mon projet—quelque chose qui ne se faisait pas à l’époque!—de tout faire en libéral, ce qui m’a permis de choisir quels thérapeutes allaient dans le sens de ce qui marchait aux États-Unis.
L’équipe thérapeutique autour des enfants a tout axé sur le ludique, passer un bon moment… au point où mon fils cadet me disait “qu’il ne faisait rien en thérapie”. Effectivement, pour lui tout était jeu, là-bas… mais en vrai, il ne se rendait juste pas compte des progrès en verbal, social, psychomoteur, empathie cognitive, etc., qu’il faisait grâce aux thérapeutes qui enrobaient tout apprentissage de ces jeux.
De mon côté, j’ai persévéré en utilisant le ludique, en faisant des démonstrations… jusqu’au jour où je me suis demandé si je n’en faisais pas un peu trop, et si ce n’était pas, tout simplement okay si ils avaient leurs propres manières de jouer. Je n’ai du coup continué que pour les choses essentielles qui avaient trait à l’autonomie et leur inclusion dans la société.
Ça a pris du temps, mais j’ai pu passer de mon rôle de maman-fait-tout (thérapeute, infirmière, chercheuse, etc.—comme tous les parents d’enfants malades ou handicapés, finalement, qui doivent de fait être experts de la pathologie de leurs enfants) à celui de maman tout court (ou presque) maintenant.
Nadia— Du coup, ça me permet de te parler du travail de l’équipe Suisse dont font partie partie Sanne Stijve et Alak Tardy sur le jeu de rôle favorisant le développement interpersonnel. J’ai pu assister à leur conférence en 2018 à Lille (Le jeu de rôle comme système de simulation favorisant le développement interpersonnel) et c’est eux qui m’ont donné envie de pousser l’expérience avec le jeu de rôle et à l’utiliser de plus en plus dans mon métier.
Ils ont beaucoup utilisé le jeu de rôle pour les apprentissages sociaux à la fois en jeu (à travers les personnages) et à la table (entre joueuses). Tout ce qui était vu en partie était longuement débrieffé à la fin du jeu, parce qu’on te dira tous que l’important c’est de savoir réutiliser les nouvelles informations et compétences acquises dans la vie et que pour ça, il faut un long débrieffing!
Voici aussi une intervention de colloque filmée à Paris 13 qui devrait t’intéresser. Elle parle d’adapter le jeu de rôle à l’enfant. Avec Alak, on a aussi donné une interview sur Radio Rôliste en 2021 sur le sujet: Pédagogie et jeu de rôle.
Pour parler de mon travail au quotidien, j’ai plusieurs enfants avec TSA (Trouble du Spectre Autistique) dans mes clubs de jeux de rôle à la MJC, et je les vois utiliser le jeu de rôle comme incubateur de la vraie vie. Ils testent tous les comportements en jeu et regardent ce que ça provoque chez les PNJs (et chez les autres joueurs et joueuses à la table).
Il n’est pas rare qu’ils se fassent rabrouer parce que leur personnage fait “n’importe quoi” aux yeux des autres qui ne comprennent pas leurs difficultés d’apprentissage social. Mais on résout les conflits avec des méthodes de communication non violentes et en discutant franchement.
Le club n’est pas un endroit où on se juge, c’est plutôt un endroit d’échange. Il y a des jeunes qui sont arrivés en tremblant avec une capuche sur la tête et une phobie sociale à crever le plafond, et qui sont ressortis la tête haute après avoir réussi à co-créer un jeu avec d’autres.
Petit à petit, leur connaissance des codes sociaux s’affine. On discute souvent ensemble de pourquoi tel comportement provoque telle réaction, et je me débrouille souvent pour introduire une composante émotionnelle dans le jeu (les jeunes doivent trouver comment faire parler certains PNJs ou comment réagir face aux émotions de PNJs qui ne sont pas simplement “méchants” mais souvent tristes, en colère légitime, ou rejetés).
Je me rappelle des débuts de ces jeunes il y a deux ou trois ans: ils aimaient le jeu de rôle parce que tout se résolvait simplement pour eux en terme de combat et de règles! J’ai introduit d’autres choses en jeu, et je leur ai fait comprendre que souvent le combat n’était pas nécessaire. Même si aujourd’hui ils jouent encore parfois de manière cathartique (“je pète tout!!”), ils ont des stratégies de résolution des problèmes et de gestion des relations inter-personnages bien plus évoluées qu’avant.
Pour tout te dire, aujourd’hui, certains sont en quatrième et je les fais jouer à une version (très) édulcorée de Monsterheart (un de mes jeux préférés qui va sortir aux éditions Lapin Marteau, et qui est un sacré terrain d’expérience pour comprendre les liens sociaux, les dynamiques de pouvoir et le rejet et la différence). C’est devenu un de leur jeux préférés, parce qu’ils expérimentent des comportements sociaux qu’ils n’osent pas avoir dans la vraie vie ou qui leur ont posé problème. Je pense que le jeu de rôle leur donne réellement pleins de clés!
Susciter l’intérêt
Nathalie—C’est hyper encourageant comme expérience, et tellement positif! Nous, à la maison, nous avons tenté les jeux de plateau avec nos deux fils, mais aussi le jeu de rôle avec mon cadet (mon aîné n’a pas encore les capacités d’évoluer dans des situations hypothétiques, tout reste difficile à expliquer au niveau de la compréhension verbale, et nous évitons donc de le mettre dans des situations où il va probablement se retrouver très vite en échec).
Mon fils cadet adore la partie combat. Les règles, ça lui parle, et il a une audace et un courage fou (voir même suicidaire) pour la partie “je-t’y-fous-dessus”. Par contre, dès qu’il s’agit de faire du roleplay, de chercher des indices, de résoudre des énigmes, nous nous sommes vite rendus compte que cela l’ennuie au plus haut point—probablement parce que c’est justement là où il a des difficultés. Du coup, Sandy a adapté les parties de manière à ce que ça fritte plus, et qu’il ait plus d’occasions de participer—sinon, on le voit se renfermer comme une huître et il part dans son petit monde intérieur au lieu d’écouter le reste de l’histoire.
De part son handicap, il a aussi énormément de problèmes à faire des choix—au point où, mis au pied du mur, il va choisir au hasard pour se débarrasser, même si c’est clairement un choix peu judicieux.
Mais je m’interroge sur comment l’amener à être plus impliqué dans son personnage (à part le nom et les stats, j’ai l’impression qu’il n’en a un peu rien à fiche du background) et dans le scénario. Aurais-tu des idées ou astuces?
Nadia—La première question que j’ai envie de te poser c’est: “est-ce que c’est lui qui créée son personnage?”. Je pense que créer son perso, c’est la porte d’entrée pour s’y intéresser.
Ensuite peut-être qu’il faut l’impliquer aussi dans la création du background, à travers des questions courtes auxquelles il répond lui-même, que tu pourras rajouter et qui touchent à l’émotionnel qu’il aura en commun avec son perso. Par exemple je demande très souvent à mes jeunes:
- “Quel est le plus grand rêve de ton personnage?”
- “Quelle est sa plus grande peur?”
- “Qui est la personne la plus proche de lui?”
Tu trouveras ici d’autres exemples pour remettre de l’émotion en jeu dans cet article que j’ai écrit avec les Lapin Marteau. Ensuite il suffira de réutiliser les réponses à ses questions pour créer ou amender les scénarios, ça devrait piquer sa curiosité et l’aider à avoir plus de perméabilité entre lui et son personnage.
Un autre truc: au début, je prends des univers de jeu que les jeunes adorent (manga, dessins animés, BD, etc.). Ils arrivent mieux à incarner un personnage qui existe déjà et qu’ils connaissent bien, donc je les laisse choisir dans leurs personnages préférés et on part de ça pour faire le background et en déduire les compétences.
Pour la partie combat et l’appétence pour la bagarre, je retrouve bien ce que j’ai connu chez mes jeunes aussi! Parfois je leur dis: “ici, on ne va pas résoudre l’action avec les dés, mais si tu me joues la scène et que tu convaincs mon PNJ, alors tu auras une réussite automatique”. C’est une nouvelle règle, simple, dont il pourra s’emparer pour faire du roleplay.
Créer des objets de jeux pourra l’aider: il a besoin de concret, de manipulations pour ne pas partir en rêvasserie. N’hésite pas à fabriquer des messages codés, des casse-tête, mets des dessins, des plans, etc.
N’hésite pas non plus:
- à changer la musique quand il y a des scènes sur lesquelles tu veux qu’il se concentre,
- à changer le ton de ta voix ou à faire les voix,
- à le faire écrire des messages secrets qu’il te donne plutôt que de chuchoter…
Et sinon en vrai, ne t’inquiète pas—c’est fréquent que les débutants se jouent eux-mêmes plutôt que le personnage, ou qu’ils imaginent leurs persos comme ceux de certains jeux vidéo: interchangeables et uniquement sélectionnés sur des compétences qui les intéressent.
Incarner un personnage, ça demande des compétences sociales (comme l’empathie) assez fortes, et ils ne développent pas tous ces capacités tôt. Tu peux lui faire faire un peu de théâtre d’impro pour l’aider à les acquérir, ou du jeu de rôle grandeur nature.
Enfin pour la difficulté à faire des choix: je retrouve souvent ça aussi chez les jeunes avec qui je fais du soutien scolaire. Pour les aider je réduis leurs choix à deux ou trois maximum au début, puis je leur explique directement les conséquences des différents choix. Au fur et à mesure, je n’explique plus que les conséquence du choix qu’ils font, en demandant si ils veulent changer de choix après cela. Et enfin dans un troisième temps je les laisse se dépatouiller, et si le choix n’est pas judicieux je leur demande: “qu’est ce qui va se passer si tu fais ça, à ton avis?”—et je les aide si besoin.
Simplifier pour faciliter
Nathalie—C’est vraiment passionnant comme astuces, et tellement concret. Merci!
Pour rebondir sur le sujet… Moi qui ne suis pas MJ, j’adorerais avoir des conseils sur comment adapter un jeu de rôle pour un public différent.
Par exemple, mon fils est un grand fan de Stranger Things. Il me semble que Tales from the Loop pourrait être un univers qui lui plairait, du coup. J’ai vu dans ton article sur les émotions que tu le recommandais, d’ailleurs.
Aurais-tu des points à partager pour permettre à un public jeune et/ou neurodivergent de jouer à Tales from the Loop, comme des simplifications de règles faciles à implémenter, ou même des conseils plus généraux?
Nadia— J’ai quelques idées qui pourront peut-être aider! Par exemple, je regarde toujours dans un jeu quelles sont les règles essentielles pour faire tourner le jeu et les règles plus “secondaires”. J’enlève les règles secondaires dans un premier temps, et on ne joue qu’avec le strict minimum. Puis, si le jeu plaît, petit à petit je rajoute une règle par ici, une par là… et le jeu se complexifie au rythme du public.
Une seconde technique est de me demander “quel but je veux obtenir avec ce jeu?”. Peut-être que c’est juste de s’amuser, et que du coup il n’est pas nécessaire d’être trop à cheval sur les règles. Peut-être que c’est que le public apprenne des compétences sociales via ses interactions avec les PNJ… et du coup je vais adapter le jeu en fonction de ça. J’ai écrit un guide sur ça qui te donnera des idées, peut-être. Il est bourré de conseils pour les MJ débutants.
Dans le cas de Tales from the Loop, c’est un jeu vraiment accessible: les règles sont très simples tu auras peu de travail de simplification! Il faut aussi parfois être prudent·e·s avec des jeux trop enfantins comme My Little Pony ou Donjons et Chatons. Bien que je les trouve formidables, il y a un travail de simplification des règles non négligeable pour jouer avec certains publics.
Et enfin je vais te donner mon “truc” pour commencer à jouer avec n’importe quel public en claquant des doigts: je prends un d6 et j’explique:
- “1-2 c’est raté, tu devras trouver une autre solution”.
- “3-4 c’est réussi mais il y aura un problème que je te dirais en jeu”.
- “5-6 c’est réussi parfaitement comme tu veux, et en plus c’est toi qui me raconte comment c’est trop bien réussi”.
Déjà rien qu’avec ça tu peux jouer des heures! Et après tu peux rajouter dessus des systèmes de bonus de +1 ou +2 si les personnages utilisent certains objets ou si tu mets en jeu des compétences (en général je mets un à deux objets ou tour de magie, et deux compétences par personnage).
Le jeu de rôle comme propulseur de développement personnel
Nathalie—Pour ma part, le jeu de rôle m’a aussi aidée dans des moments difficiles de ma vie. Incapable de poser des limites, me faisant écraser dans ma vie personnelle et professionnelle, deux choses m’ont aidées à surmonter mes difficultés: avoir des sessions régulières avec une life coach, mais aussi avant cela de faire des “répétitions” avec une amie.
On se mettait en situation de conflit, et elle jouait “l’adversaire” et essayait de me coller. C’était à moi de faire fonctionner mes muscles de développement personnel pour arriver à me sortir de ces échanges—le tout dans un cadre sécurisant, puisque l’échec de ces interactions ne portait à aucune conséquence négative, et que je savais que cela me permettait de travailler mes réponses à d’éventuels—ou plutôt probables—conflits ultérieurs.
Je trouve que cette pratique, très proche du véritable jeu de rôle, est une technique très efficace pour prendre confiance en soi et ne pas se retrouver au dépourvu face à des toxiques (surtout quand on est pas habitué·e·s à gérer ces agressions verbales). Y a-t-il, dans ta pratique, des équivalents? Par exemple, pour préparer un conflit, ou “rejouer” une situation pour apprendre à mieux la gérer la prochaine fois, le tout de façon ludique pendant une partie de jeu de rôle?
Nadia— Oui! Déjà je suis thérapeute aussi dans la vie en plus d’être pédagogue donc je fais rejouer à mes patients les scènes oppressives comme au théâtre de l’opprimé et on réfléchit ensemble à comment désamorcer ou gérer la situation. Rien que ça, c’est déjà du jeu de rôle, et ce type de pratique est employé par certains psy depuis des lustres.
Dans ma pratique du jeu de rôle sur table thérapeutique, je “métaphorise” une situation embêtante avec certains patients. Je change le contexte, mais la situation est la même et le ou la patiente s’entraîne avec un PNJ.
Je vais te donner un exemple concret: pendant trois ans, j’ai travaillé avec Clément un super orthophoniste du Nord, et trois des jeunes qu’il suivait pour troubles de la fluence. Quand Clément m’a contacté, il m’a dit: “j’ai fait tout ce que j’ai pu au niveau orthophonie, mais je sens que j’arrive au bout et j’ai besoin de toi pour faire du jeu de rôle thérapeutique pour gérer le côté émotionnel de leur bégaiement et zozotement. Je vois bien que c’est aussi le stress qui les bloque malgré tout ce qu’ils ont appris”.
On a travaillé sur des situations stressantes remises en jeu: chronomètres qui se déclenchaient avant qu’un PNJ soit définitivement perdu, responsabilité d’un PNJ plus faible qu’eux… et on a même rejoué une situation où un PNJ se moquait du handicap d’un autre PNJ et les personnages des enfants devaient défendre le PNJ opprimé.
Cette dernière situation a raisonné fort avec les moqueries que les jeunes subissent au quotidien à cause de leur trouble de la fluence. Ils ont su, avec le recul du personnage, trouver quoi dire, quoi faire pour arrêter le PNJ oppresseur en jeu et on leur a souligné en fin de jeu que maintenant ils savaient aussi se défendre dans la vraie vie en faisant exactement la même chose qu’en jeu.
Enfin, je travaille beaucoup sur le conflit et grâce au jeu de rôle sur table, certains patients ont maintenant moins peur du conflit (je les ai surentrainé avec des interactions PJ-PNJ parfois hyper éprouvantes), ou savent mieux désamorcer les montées en tension.
Nathalie—Merci Nadia pour ta présence et ta bienveillance! Je suis sûre que les points que tu as soulevés vont permettre à plus d’un d’utiliser ces adaptations pour rendre leurs JDRs pédagogiques ou thérapeutiques, en plus de ludiques. 😊

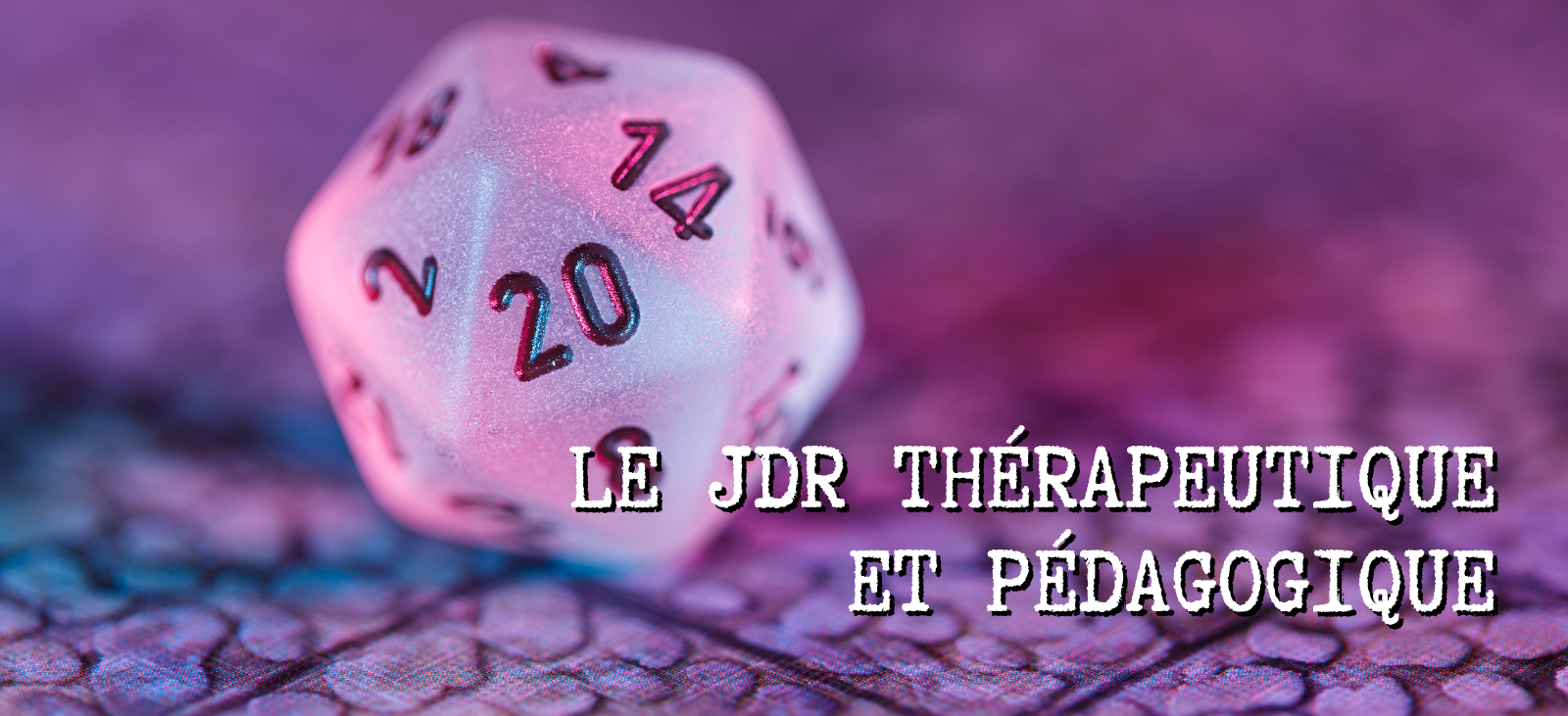

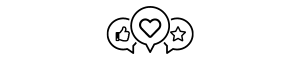

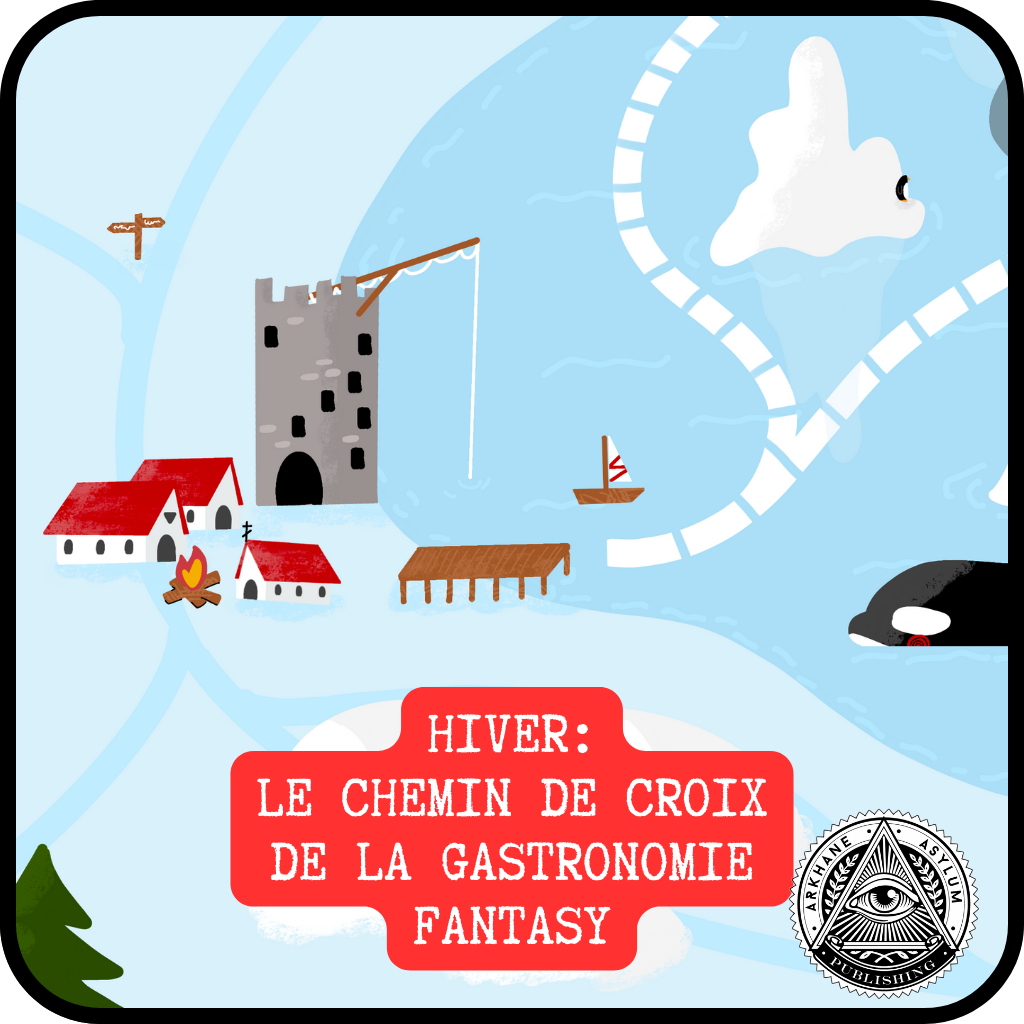


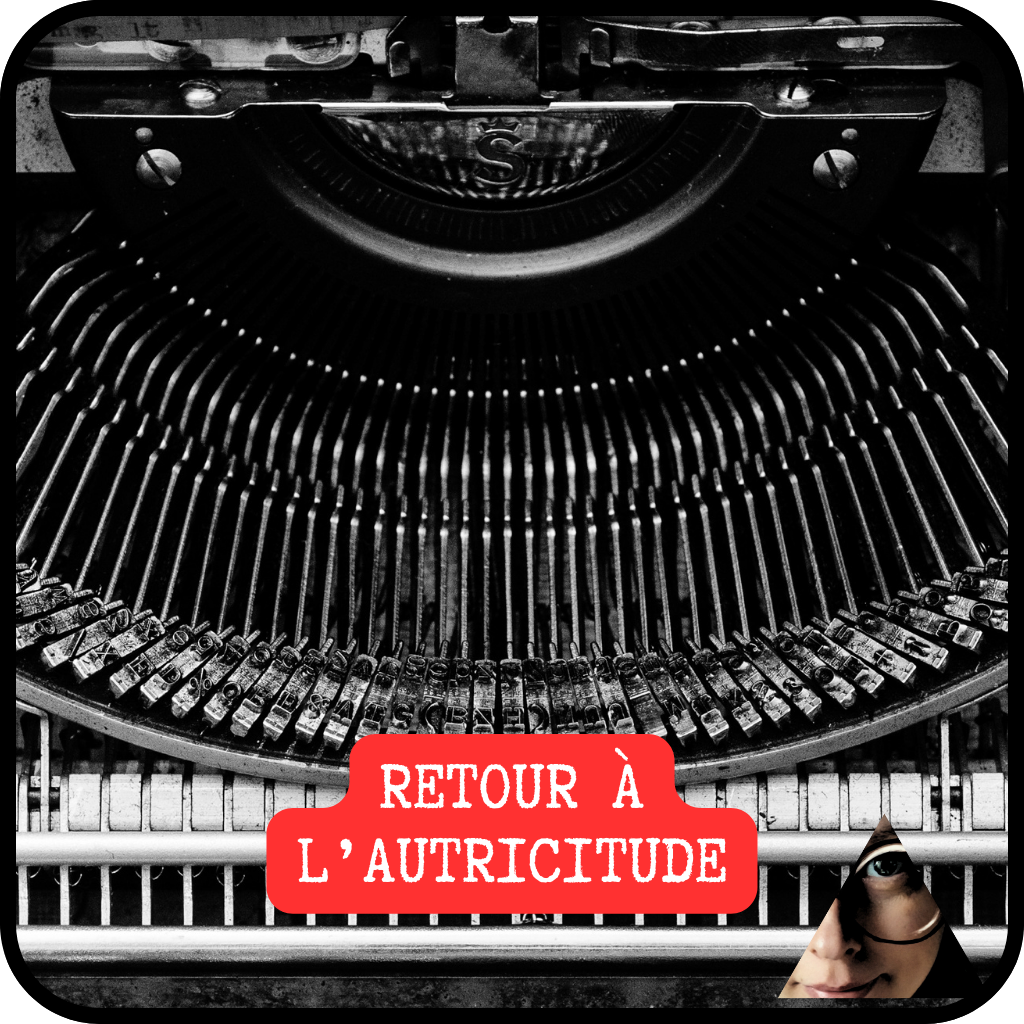
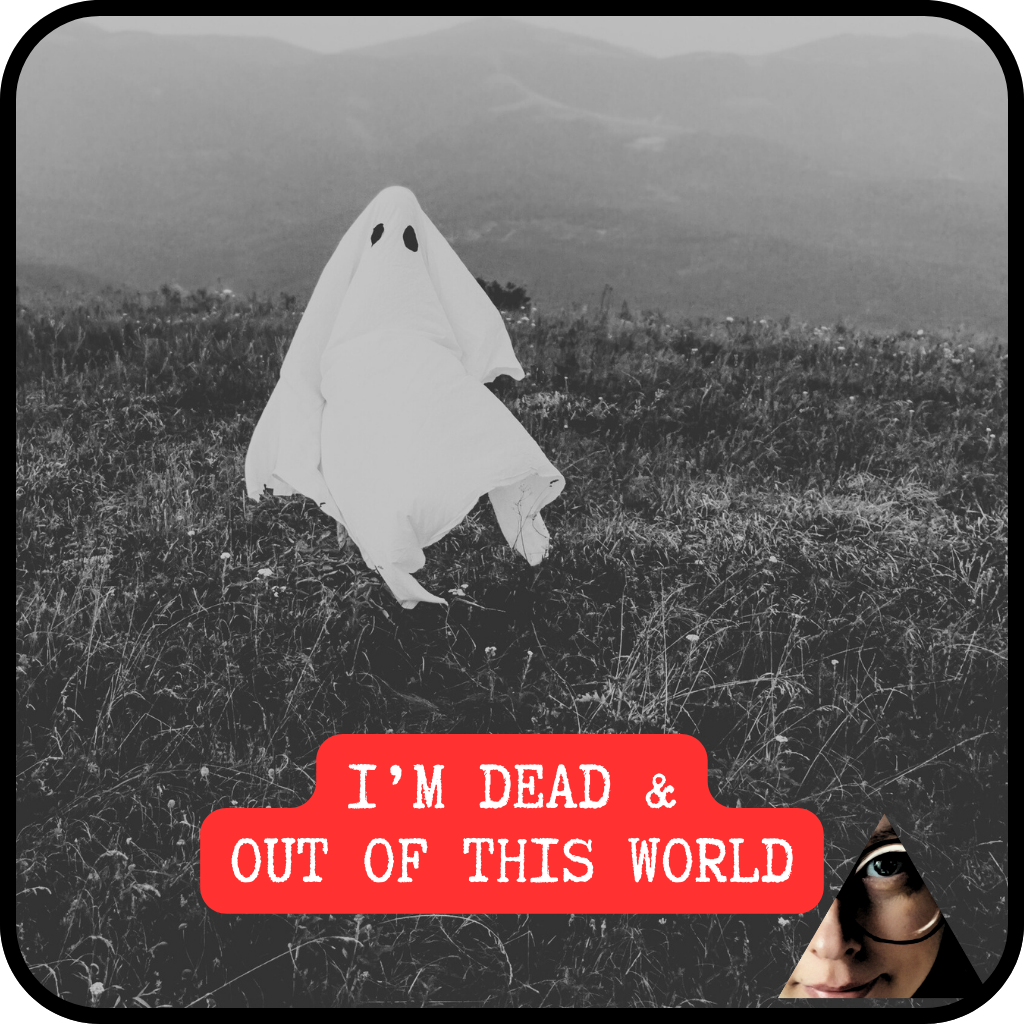


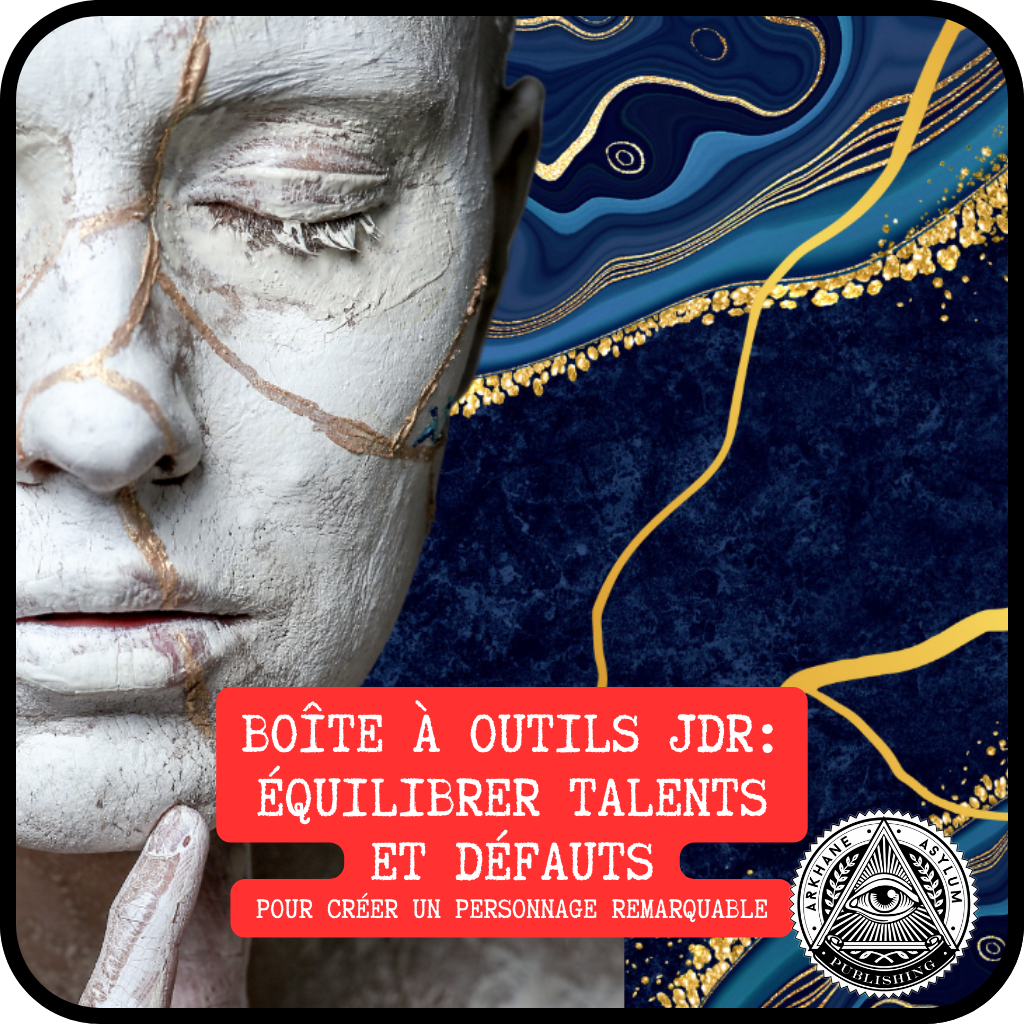
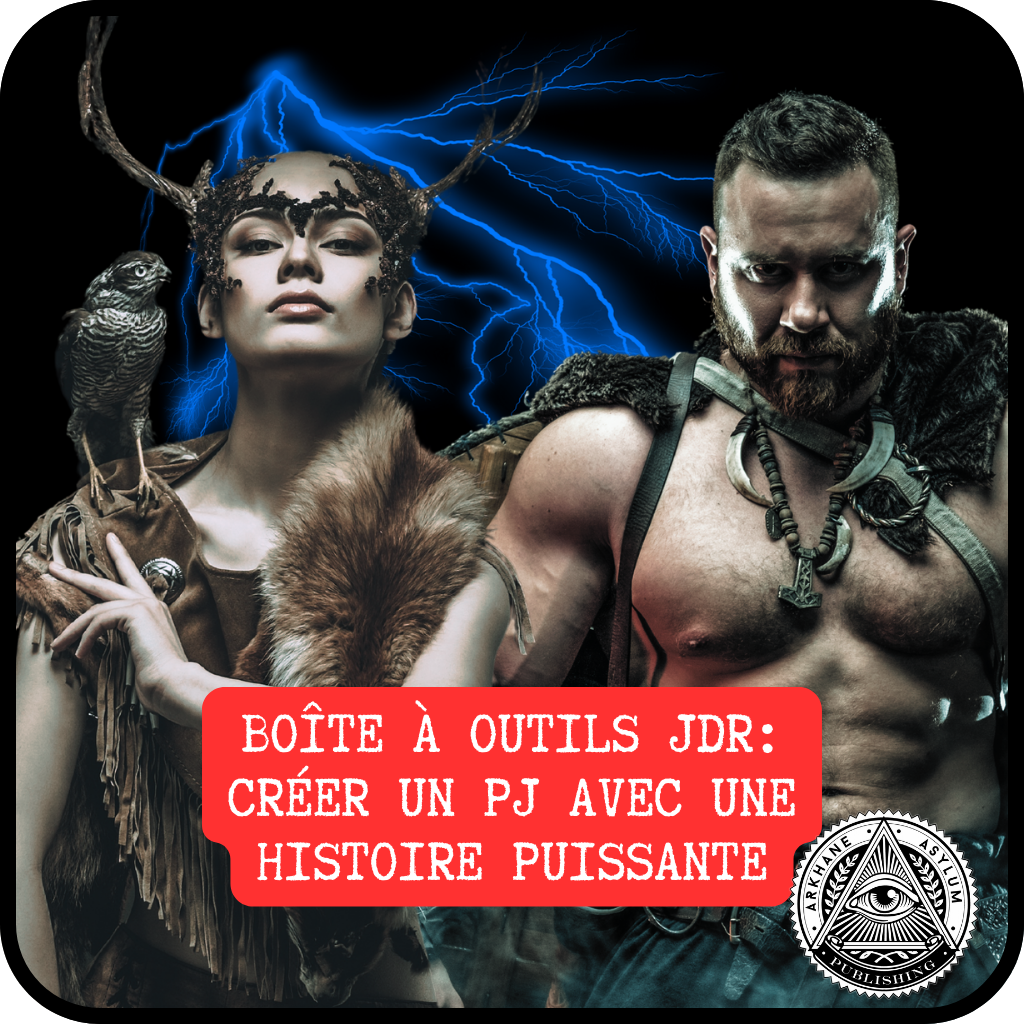

0 Comments